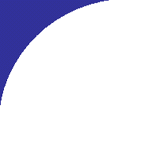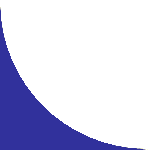|
A
Haut de page.
|
Alléluia
: "Louez Yah" (halelou yah). Louez Dieu ! Appel à la louange
introduit dans le culte du Temple après l'exil. "Yah"
est la contraction du Tétragramme ou nom ineffable
de Dieu donné à Moïse.
Assidéens : (Hasidîm)
Ardents défenseurs de la Loi de Moïse qui, au temps des Maccabées, luttèrent
à leur côté. Les pharisiens
se déclarent continuateurs de ce groupe. Jude le
synhédriste, sympathisant de la cause
de Jésus, s'affiche comme le dernier descendant de cette race.
|
|
B
Haut de page.
|
Bat
Kol (fille de voix) désigne la voix
divine telle qu'elle se fit entendre du peuple sur le Sinaï. Cette voix a retenti
par trois fois dans l'Évangile : lors du Baptême de Jésus (2.3
- 2.4 - 5.12),
de la Transfiguration (5.37)
et de la Glorification précédant la Passion (9.17).
Bel Nidrash
= voir Beth Midrash
Bouc
émissaire : 9.6
Byssos (Byssus) : Lin très fin,
proche de la gaze, employé souvent dans les voiles que portent les femmes
élégantes (1.13 - 3.27
- 3.52 - 3.57)
mais aussi dans les vêtements riches, par exemple dans la parabole du riche
et du pauvre Lazare (Luc 16,19)
reprise en 3.52.
|
|
CD
Haut de page.
|
Caroseth ou Harosset
: Un des aliments traditionnels du repas pascal. C'est un gâteau dont
l'aspect rappelle le mortier que les israélites devaient pétrir pour le
Pharaon du temps de leur esclavage (10.20). Les
autres aliments du rituel (Seder pascal)
sont les herbes amères (maror), le matzo (matsa) ou pain sans levain selon le récit de l'Exode, le karpas ou
légume simple trempé dans l'eau salée en souvenir de la douleur de
l'esclavage, le zeroah (Z'roa) et
un œuf dur (beitzah),
symbole de deuil.
Corban = Qorban
|
|
EF
Haut de page.
|
Encénie(s) – nom féminin issu du grec egkainia ou Kainos (nouveau).
C'est la fête (Hanouka ou Chanukkah)
que les Juifs célèbrent le 25 du neuvième mois (Kislev
ou Casleu, soit novembre/décembre), en mémoire de
la purification du Temple par Judas Macchabée, après qu'il eut été pillé et
profané par Antiochus Épiphane. Cette restauration ou rénovation désignait
non seulement celle que fit Judas Maccabée, mais l'Encénie
s'applique aussi à la dédicace du Temple de Salomon et à celle que fit
Zorobabel après le retour de captivité. Par la suite ce mot est passé dans
l'Église sous le pape Félix (Félix I au IIIème siècle ou Félix III au Vème
siècle ?) pour désigner la dédicace ou l'inauguration d'une église (2.99)
Ephod, Rationnal :
Esséniens :
Ils ne sont connus ni du Talmud, ni du Nouveau Testament. Seuls des auteurs
antiques en font mention, tels Philon d'Alexandrie
ou Flavius Josèphe qui les fréquenta.
Leur connaissance a progressée avec la découverte des manuscrits de Qumram en
1948 et les travaux du professeur Éléazar Sukenik.
À cette époque l'œuvre de Maria Valtorta était déjà présentée à Pie XII. Elle
y mentionne pourtant la présence d'une communauté essénienne dans la région
de Qumram.
Elle fait aussi preuve d'une connaissance approfondie de leurs croyances :
certaines sont incompatibles avec l'enseignement de Jésus et donc avec son
appartenance à ce mouvement. À Judas, qui le croyait réfugié
auprès d'un maître essénien lors de ses quarante jours de jeûne, Jésus répond
: "Pouvais-je aller chercher science et compréhension chez des gens qui
nient l’immortalité de l’âme en niant la résurrection finale, qui nient le
libre arbitre de l’homme en renvoyant dos à dos vertus et vices, actions
saintes et actions mauvaises, réglées par une destinée qu’ils disent fatale
et invincible ?". Un seul essénien devient disciple de Jésus : Élie.
Il quitte sa communauté pour cela. (5.71).
|
|
G
Haut de page.
|
Gazophylacium :
mot d'origine gréco-persane qui désigne littéralement un contenant de
richesses. C'est le nom donné au coffre ou au tronc où les hébreux déposaient
leur offrande pour le Temple (Luc 21,1). On les déversait, par des bouches
d'animaux sculptés sur un mur, dans le gazophylacium
conservé dans une salle. Ce terme est employé dans la Vulgate "Recipiens autem, vidit eos qui mittebant munera sua in gazophylacium, divites" (Levant
les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor)
(EMV 596.4)
Gentils : Ce terme vient du latin "Gentiles" utilisé par la Vulgate
: qui appartiennent aux "gentes",
aux nations. C'est la traduction du mot hébreu "goïm", pluriel de
"Goï". En grec, "Ethnê".
Gentils désigne donc tous ceux qui sont étrangers au peuple juif, peuple mis
à part de façon unique par Dieu et pour Dieu (Deutéronome
26,18-19). Même si toutes les nations
sont destinées au Salut (nombreux passages d’Isaïe dont 42,6), ce terme a
parfois un sens péjoratif.
Goulal : "Oh
! on ne se venge pas sur un gulal !". Ce
terme, employé pour désigner Lazare mourant (EMV 542)
n'est pas explicité. Au plus proche du mot Goulal,
on ne trouve que le goël (gâal)
qui est historiquement le protecteur d'un clan dans la législation mosaïque.
Par extension, cela peut s'appliquer à un défenseur qui agit au nom d'un
autre incapable de le faire. Un autre rapprochement pourrait se faire avec la
goule, ce vampire qui, selon les légendes orientales, dévore les cadavres
dans les cimetières.
Grand Prêtre
: Voir liste des Grands Prêtres – La notice historique sur les habits du Grand Prêtre
– Vision de Maria Valtorta lors de l'entrée de Marie au
Temple
|
|
HIJ
Haut de page.
|
Hérodiens
: Partisans de Hérode le grand puis de Hérode
Antipas. Ils étaient plus soucieux de
tirer profit de l'occupation romaine que de défendre les valeurs
traditionnelles de leur patrie. Souvent sadducéens, ils n'hésiteront pas à
s'allier aux pharisiens contre Jésus. 9.13
Hosanna : veut
dire "sauve donc !", "donne le salut !"
|
|
KL
Haut de page.
|
Léviathan : Monstre marin biblique. Assimilé parfois à un
crocodile. (Isaïe, 27,1) (2.21 - 4.117
– 8.5)
|
|
M
Haut de page.
|
Mammon
: Mammon est un terme araméen qui désigne les richesses, tout ce qui assure
la sécurité matérielle et finalement une sorte de divinité qui
personnifierait l'argent, et son culte idolâtre. Il est souvent employé dans
les écrits rabbiniques. (voir la fiche)
Maran-Atà
: Maranatha - Maran-Atha
- Invocation solennelle. En araméen : "le Seigneur vient". C'est
l'invocation retenue dans Maria Valtorta. Ces mots peuvent se lire aussi
Marana Tha : "Seigneur, viens!". 6.130
- 9.7
- 10.24. L'équivalent
aussi, semble-t-il, de "qu'il en soit ainsi" 7.170. Cf. première épître aux corinthiens 16,22 et Apocalypse
22,20
Midrash (midrach) : Ce mot s'applique
à une exégèse et un lieu d'enseignement du Temple.
- Une exégèse : méthode d'exégèse rabbinique de la Bible
(voir ci-dessous)
- et un lieu
d'enseignement dit "Bel Nidrasch"
: En fait le Beit Midrach
ou Beth Midrash ou Bet Midrach
(בית
מדרש). C'est une salle d'étude de la Torah ou école rabbinique qui
maintenant se trouve dans beaucoup de synagogues. On en
fait remonter l'origine à la destruction du Temple.
Cependant, dans l'œuvre de Maria Valtorta, il s'agit clairement d'un endroit
du Temple réservé à l'enseignement, contemporain du Christ : "Nous voilà au Temple. Moi je vais au Bel
Midrash, pour enseigner les foules" (2.30). Si
l'on en croit le chapitre suivant, il serait situé "dans l'enceinte du Temple, après avoir franchi la première terrasse
ou la première plate-forme, dans un endroit entouré de portiques et proche
d'une grande cour, pavé de marbres de couleurs variées. L'endroit est très
beau et fréquenté". Il est nécessaire de demander à un magistrat
l'autorisation d'y enseigner. (2.31).
Voir aussi 2.78 - 4.106
- 7.187
À noter qu'il s'agit d'un des
nombreux cas où Maria Valtorta transcrit phonétiquement des termes
spécialisés ou des noms propres. La source est en effet ce qu'elle entend (et
voit) mais non ce qu'elle a appris (et lu). Bien plus, l'orthographe d'un
même mot ou d'un même nom, peut varier d'un épisode
à l'autre.
|
|
N
Haut de page.
|
Naziréat
(nazirat) - D’un mot hébreu qui signifie "séparer",
"consacrer" ou "s’abstenir". Le naziréen (ou nazir) était une personne qui se séparait par vœu spécial
des autres pour se consacrer à Dieu. Les règles qui s’appliquent au naziréen
sont énumérées dans Nombres 6. Il, ou
elle ne devait prendre ni vin, ni autre boisson excitante, ni vinaigre, ni
raisins. Il ne devait pas se couper les cheveux pendant toute la
période de consécration. Les cheveux étaient considérés comme le siège de la
vie et devaient être conservés dans leur état naturel. Il ne pouvait pas
s’approcher des morts et, si cela lui arrivait, il devait accomplir des rites
de purification élaborés et recommencer son vœu depuis le début. Lorsque le
vœu était accompli, il devait faire des sacrifices particuliers et le prêtre
le déliait du vœu. Bien que le vœu ait concerné d’ordinaire une période
limitée, certains parents consacraient leur enfant pour la vie (par exemple Samuel). Le mot naziréen pouvait s’appliquer dans un sens plus
large à des personnes consacrées à Dieu, puisque Samson prenait du vin. Il
est difficile de trouver des exemples de naziréens temporaires avant l’Exil
mais, par la suite, cela devint plus courant (le vœu naziréen de Paul dans Actes 18.18).
Source BibleOnLine.
|
|
OP
Haut de page.
|
Oncle
et Tante : "Pour les chicaneurs, je dis que
j'ai employé les termes "oncle" et "tante", qui
n'existent pas dans les langues de Palestine, pour apporter des
éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur
ma condition de Fils Unique de Marie, et sur la Virginité de ma Mère, avant
et après l'enfantement, sur la nature spirituelle et divine de l'union dont
j'ai reçu la vie. Je le redis encore une fois, ma Mère ne connut pas d'autres
unions et n'eut pas d'autres enfants. Chair Inviolée, que Moi-même je n'ai
pas déchirée, fermée sur le mystère d'un sein-tabernacle, trône de la Trinité
et du Verbe Incarné". (2.65)
Pâque et Pâques :
Bien que les deux termes soient au singulier, le premier désigne la sortie
d'Egypte et le second, écrit avec un s,
commémore la Résurrection du Christ en plus de la libération des Hébreux de
leur esclavage.
Paranymphe :
l'ami(e) de l'époux(se) qui le(la) conduit dans la
maison nuptiale. Le paranymphe est l'ami confident,
le parrain, le témoin, l'entremetteur dans les noces. Ce rôle fait encore
partie des liturgies de mariage de certaines Églises orientales dans
lesquelles une prière est spécialement faite sur eux après celles sur les
époux. (2.70)
Parascève (Préparation) désigne la veille du
sabbat, le vendredi soir (Marc 15,42). Le sabbat, comme toutes les journées juives, s'étend
du soir (vendredi) au soir suivant (samedi) aux environs de 18.00. (2.18 - 2.47
- 3.55
- 5.61
- 5.62)
Pharisiens :
(Peroushîm) Continuateurs des Hasidîm ou assidéens. Peroushîm veut dire "séparés". Les pharisiens
constituaient une grande partie des synhédristes,
que ceux-ci soient dans la classe sacerdotale, les grands propriétaires ou
les scribes.
Publicains
(Publicanus en latin)
Ils sont le dernier rouage des collecteurs d'impôts, fonction achetée à
l'Etat par des citoyens riches qui employaient ce réseau de collecteurs
subalternes. Cette fonction d'origine romaine, s'étendit à tout l'empire.
Leur fonction, leur alliance avec le pouvoir d'occupation, autant que leur
pratiques d'extorsion les rendirent impopulaires. (2.62)
|
|
QR
Haut de page.
|
Qorban
(offrande) : argent ou service mis à part pour Dieu. Ils ne pouvaient plus
servir alors à des buts séculiers ou même sociaux (7.219)
|
|
S
Haut de page.
|
Seconde
Pâque (ou Petite Pâque) - Si, le jour de la Pâque, quelqu'un
se trouvait accidentellement impur (par exemple en ayant touché un mort) une
disposition spéciale permettait à cette personne de recommencer validement la
Pâque un mois après. (Cf. Nombres
9,6-12)
Cette seconde Pâque donnait lieu à une notation liturgique, identique par
exemple à celle qu’utilise l’Église catholique en parlant de "deuxième
dimanche après Pâque".
Jean-François
Lavère a ainsi identifié la
notation de "sabbat second-premier" mentionné en Luc 6, 1.
qui rapporte l’épisode de Jésus, maître du
sabbat (EMV 217).
Cette notation est si incompréhensible que beaucoup de Bibles omettent ce
passage, pourtant noté dans la Vulgate, et que d’autres le mentionnent sans l’expliquer.
Déjà quand Jérôme de Stridon (347-420) traduit sa Vulgate, il interroge
Grégoire de Naziance (329-390), théologien et Docteur de l’Église, qui lui
avoue être incapable de lui fournir une réponse satisfaisante. À cette époque
on ne savait donc plus la signification exacte de cette notation.
Selon l’exégèse du texte de Maria Valtorta faite par Jean-François Lavère, il
s’agit à l’évidence du premier sabbat après la seconde Pâque, fête qui tomba
en désuétude dans le judaïsme après la chute du Temple.
Cette précision restaure une notation voulut par Luc. Elle correspond tout à
fait à l’approche de la Pentecôte, fête où l’on moissonnait
traditionnellement le blé.
Sadducéens : (Saddocites,
sadocides) groupe politique et religieux formé des
riches familles sacerdotales.
Leur nom vient du prêtre Sadoq, placé par Salomon à la tête du clergé de
Jérusalem.
À l’époque de Jésus, les sadducéens étendent leur emprise sur le corps
sacerdotal et sur les notables de la société.
Selon Flavius Josèphe, "Ceux de cette secte sont en petit nombre mais
elle est composée des personnes de la plus grande condition".
Ils s’en tiennent à une lecture restrictive de la Torah et refusent toute
interprétation. C’est ainsi qu’ils nient l’immortalité de l’âme, non
mentionnée explicitement dans l’Écriture. En conséquence, il n’y a pas de
châtiments ou de récompenses dans l’autre monde, pas de résurrection (EMV
594). De même ils nient
l’existence des anges et des esprits. Pour eux n’existe que la vie terrestre
durant laquelle il convient de respecter les lois sacrées pour jouir d’un
bonheur terrestre.
Selon Maria Valtorta, Judas, qui fut fonctionnaire du Temple avant d’être
disciple, partageait leurs croyances : il ne croyait ni à l’Enfer, ni à Satan.
Au Sanhédrin, le collège des prêtres était très majoritairement
sadducéen et hostile à Jésus. Cependant, cinq de ses membres, tous anciens
Grands-Prêtres manifestèrent sympathie ou neutralité envers Jésus.
Samaritains : Voir la fiche thématique.
Saphorim
: (Sopher - Sopherîm) les scribes. À l'origine le terme désignait
ceux qui savaient lire et écrire et qui, comme tel enseignaient la Loi. Ils
prirent de l'importance au temps de l'exil à Babylone. Le sens évolua jusqu'à
désigner les personnes expertes de la Loi. Une des trois classes du Sanhédrin leur est d'ailleurs consacrée. Gamaliel, le
grand Rabbi, était l'un d'eux : 7.183
- 8.22 - 9.13
Sciemanflorasc : Traduction phonétique du "Schem Hammephoras".
Cette pratique magique consistait à invoquer le nom secret de Dieu : celui
que prononçait le Grand Prêtre une fois par an dans le secret du Sanctuaire.
En procédant ainsi les nécromanciens pensaient plier Dieu à leur volonté
(Abbé Bullet, Histoire de l'établissement
du Christianisme, réédition de 1825, page 140). De nos jours le schemhamphoras
est devenu un article de magie, vendu comme talisman dans les boutiques
spécialisées. Maria Valtorta écrit ce qu'elle entend, non ce qu'elle connaît
: c'est une preuve en faveur de l'authenticité de ses visions. 7.199
Shabaôt :
veut dire "armées". Ce qualificatif est attribué à Dieu en
désignant l'armée des Cieux. Il arrive aussi que ce qualificatif désigne le
Dieu sui combat avec les bataillons d'Israël. Dans le contexte de l'œuvre de
Maria Valtorta, le sens demeure obscur. 10.29
Succube : Un succube est un démon femelle sensée abuser des hommes (le démon mâle est l'incube). Cependant,
Maria Valtorta emploie le succube comme synonyme de "concubine" qui
est d'ailleurs le sens étymologique latin (succuba).
On pourrait le traduire par "suppôt", terme connoté, ou
"esprit dévoué à". Il serait intéressant d'expertiser si ce sens
correspondait aux usages de l'époque, ce que nous n'avons pas réussi à
établir. 8.36
|
|
TS
Haut de page.
|
Talmud
: Le Talmud (enseignement, doctrine)
est la source d’où les Juifs tirent leur législation. Il est composé
de :
- la Halaka (הלכה
- Halakha, Halocho,
Halacha), interprétation
juridique de l'Écriture. La Halaka contient les
règles de conduite, les ordonnances et les préceptes légaux pour le culte et
le droit (les Halâkoth). La Halaka
est prononcée Halascia en 1.67 et halachah
en 10.11.
- la
Haggada qui
comporte l'ensemble des passages du Talmud consacrés aux interprétations
éthiques et homilétiques (aux fins d’homélies, de prédication) de la Bible,
ce en quoi elle se distingue de la Halaka,. La Haggada est prononcée
Agada en 1.67 et
hagadah en 10.11
- La
Midrach
(Midrac), méthode d'exégèse
rabbinique de la Bible qui, au-delà du sens littéral tend à rechercher dans
les écrits bibliques une signification plus profonde. Les midrachim
sont des exposés théologiques.
Parmi les auteurs réputés de ces traditions midrashiques on peut citer Hillel,
Schammaï (Schammei)
et Gamaliel
(3.58). La midrach est prononcé midrasc en 1.67 et
midrashim (au féminim) en 10.11.
Midrash désigne aussi la branche du savoir rabbinique qui a trait aux règles
de la loi traditionnelle (écrite), par opposition à la Michna (tradition
orale). Cette interprétation de la Loi mosaïque donna des prescriptions
nouvelles, des règles de conduite qu’il fallait suivre sur le culte et le
droit (les Halâkoth). Toutefois, par égard pour la
Loi mosaïque, ces midrashim ne devaient être transmis de génération en
génération qu’oralement, quoique leur autorité finît par égaler pratiquement
celle de la Loi.
Tsitsits : Cordons
de couleur bleue ou violette, symbole du ciel, qui pendaient aux quatre coins
du vêtement. Ils rappelaient au fidèle, les commandements de la Loi et le
devoir d’obéissance. (Deutéronome
22,12). Ils sont maintenant
attachés au Talith (châle de prière) 7.197
|
|
UVWWXYZ
Haut de page.
|
Zélotes
: Membres d’un parti de patriotes juifs nationalistes. Judas le Galiléen qui
mena une révolte contre Rome en l’an 6 après J.C., créa ce parti à l’époque
de Quirinius, afin de résister aux Romains. Il
proclamait que le paiement de l’impôt à César était une trahison envers Dieu.
Il dégénéra en un corps d’assassins, les sicaires. Le fanatisme des zélotes
contribua à déclencher la guerre entre Juifs et Romains. (2.36)
|
|
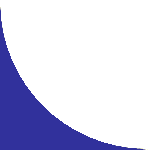
|
Haut de page
- Nous contacter
Fiche mise à jour le 25/05/2020.
|