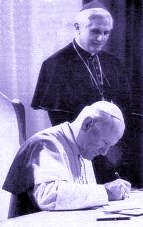|
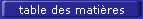
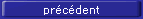

Liste des sigles.
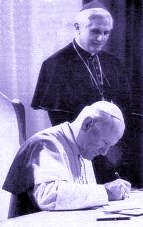
SS. Jean-Paul II et Maria Valtorta.

Les grands auteurs.

Les encycliques.
|
 Chapitre premier : les
sept sacrements de l'Église. Chapitre premier : les
sept sacrements de l'Église.
Haut de page.
 Article
3 - Le sacrement de l’Eucharistie Article
3 - Le sacrement de l’Eucharistie
1322
La Sainte Eucharistie achève l’initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés
à la dignité du sacerdoce royal par le baptême et configurés plus
profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de
l’Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du
Seigneur.
1323
"Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré,
institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour
perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il
vienne, et pour confier à l’Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa
mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de l’unité,
lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en
nourriture, l’âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous
est donné " (SC 47).
 I. L’Eucharistie – source et sommet de la vie
ecclésiale. I. L’Eucharistie – source et sommet de la vie
ecclésiale.
Haut de page.
1324
L’Eucharistie est " source et sommet de toute la vie
chrétienne " (LG 11). " Les autres sacrements ainsi que
tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à
l’Eucharistie et ordonnés à elle. Car la sainte Eucharistie contient tout le
trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre
Pâque " (PO 5).
1325
"La communion de vie avec Dieu et l’unité du peuple de Dieu, par
lesquelles l’Église est elle-même, l’Eucharistie les signifie et les réalise.
En elle se trouve le sommet à la fois de l’action par laquelle, dans le
Christ, Dieu sanctifie le monde, et du culte qu’en l’Esprit Saint les hommes
rendent au Christ et, par lui, au Père " (CdR, instr.
" Eucharisticum mysterium "
6).
1326
Enfin, par la célébration eucharistique nous nous unissons déjà à la
liturgie du ciel et nous anticipons la vie éternelle quand Dieu sera tout en
tous (cf. 1 Co 15, 28).
1327
Bref, l’Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi :
" Notre manière de penser s’accorde avec l’Eucharistie, et
l’Eucharistie en retour confirme notre manière de penser " (S.
Irénée, hær. 4, 18, 5).
 II. Comment est appelé ce sacrement ? II. Comment est appelé ce sacrement ?
Haut de page.
1328
La richesse inépuisable de ce sacrement s’exprime dans les différents noms
qu’on lui donne. Chacun de ces noms en évoque certains aspects. On
l’appelle :
Eucharistie parce qu’il est action de grâces à Dieu. Les mots eucharistein
(Lc 22, 19 ; 1 Co 11, 24) et eulogein
(Mt 26, 26 ; Mc 14, 22) rappellent les bénédictions juives qui proclament
– surtout pendant le repas – les œuvres de Dieu : la création, la
rédemption et la sanctification.
1329
Repas du Seigneur (cf. 1 Co 11, 20) parce qu’il s’agit de la Cène que le Seigneur a pris avec
ses disciples la veille de sa passion et de l’anticipation du repas des noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9) dans la Jérusalem céleste.
Fraction du Pain parce que ce rite, propre au repas juif, a été utilisé
par Jésus lorsqu’il bénissait et distribuait le pain en maître de table (cf.
Mt 14, 19 ; 15, 36 ; Mc 8, 6. 19), surtout lors de la dernière Cène
(cf. Mt 26, 26 ; 1 Co 11, 24). C’est à ce geste que les disciples le
reconnaîtront après sa résurrection (cf. Lc 24,
13-35), et c’est de cette expression que les premiers chrétiens désigneront
leurs assemblées eucharistiques (cf. Ac 2, 42.
46 ; 20, 7. 11). Ils signifient par là que
tous ceux qui mangent à l’unique pain rompu, le Christ, entrent en communion
avec Lui et ne forment plus qu’un seul corps en Lui (cf. 1 Co 10, 16-17).
Assemblée eucharistique
(synaxis)
parce que l’Eucharistie est célébrée en
l’assemblée des fidèles, expression visible de l’Église (cf. 1 Co 11, 17-34).
1330
Mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur.
Saint Sacrifice, parce qu’il
actualise l’unique sacrifice du Christ Sauveur et qu’il inclut l’offrande de
l’Église ; ou encore saint
sacrifice de la messe, " sacrifice
de louange " (He 13, 15 ; cf. Ps 116, 13. 17), sacrifice spirituel (cf. 1 P 2,
5), sacrifice pur (cf. Ml 1,
11) et saint, puisqu’il
achève et dépasse tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance.
Sainte et divine Liturgie, parce
que toute la liturgie de l’Église trouve son centre et son expression la plus
dense dans la célébration de ce sacrement ; c’est dans le même sens
qu’on l’appelle aussi célébration des Saints
Mystères. On parle aussi du Très
Saint Sacrement parce qu’il est le sacrement des sacrements. On
désigne de ce nom les espèces eucharistiques gardées dans le tabernacle.
1331
Communion, parce que c’est par ce sacrement que nous nous unissons au
Christ qui nous rend participants de son Corps et de son Sang pour former un
seul corps (cf. 1 Co 10, 16-17) ; on l’appelle encore les choses saintes : ta hagia ; sancta (Const. Ap. 8, 13, 12 ; Didaché 9, 5 ; 10, 6) – c’est le sens premier de la
" communion des saints " dont parle le Symbole des
Apôtres -, pain des anges, pain du
ciel, médicament d’immortalité (S. Ignace d’Antioche, Eph. 20, 2), viatique...
1332
Sainte Messe parce que la liturgie
dans laquelle s’est accompli le mystère du salut, se termine par l’envoi des
fidèles ("missio") afin qu’ils
accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne.
 III. L’eucharistie dans l’économie du salut. III. L’eucharistie dans l’économie du salut.
Haut de page.
 Les signes du pain et du
vin. Les signes du pain et du
vin.
1333
Au cœur de la célébration de l’Eucharistie il y a le pain et le vin qui, par
les paroles du Christ et par l’invocation de l’Esprit Saint, deviennent le
Corps et le Sang du Christ. Fidèle à l’ordre du Seigneur l’Église continue de
faire, en mémoire de Lui, jusqu’à son retour glorieux, ce qu’il a fait la
veille de sa passion : "Il prit du pain...", "Il prit la
coupe remplie de vin...". En devenant mystérieusement le Corps et le
Sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier aussi la
bonté de la création. Ainsi, dans l’Offertoire, nous rendons grâce au
Créateur pour le pain et le vin (cf. Ps 104, 13-15), fruit " du
travail de l’homme ", mais d’abord " fruit de la
terre " et " de la vigne ", dons du Créateur.
L’Église voit dans le geste de Melchisédech, roi et prêtre, qui
" apporta du pain et du vin " (Gn
14, 18) une préfiguration de sa propre offrande (cf. MR, Canon Romain
95 : " Supra quæ ").
1334
Dans l’Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice
parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Mais
ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de
l’Exode : Les pains azymes qu’Israël mange chaque année à la Pâque,
commémorent la hâte du départ libérateur d’Égypte ; le souvenir de la
manne du désert rappellera toujours à Israël qu’il vit du pain de la Parole
de Dieu (cf. Dt 8, 3). Enfin, le pain de tous les
jours est le fruit de la Terre promise, gage de la fidélité de Dieu à ses
promesses. La " coupe de bénédiction " (1 Co 10, 16), à
la fin du repas pascal des juifs, ajoute à la joie festive du vin une
dimension eschatologique, celle de l’attente messianique du rétablissement de
Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et
définitif à la bénédiction du pain et de la coupe.
1335
Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le Seigneur dit
la bénédiction, rompit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir
la multitude, préfigurent la surabondance de cet unique pain de son
Eucharistie (cf. Mt 14, 13-21 ; 15, 32-39). Le signe de l’eau changé en
vin à Cana (cf. Jn 2, 11) annonce déjà l’Heure de
la glorification de Jésus. Il manifeste l’accomplissement du repas des noces
dans le Royaume du Père, où les fidèles boiront le vin nouveau (cf. Mc 14,
25) devenu le Sang du Christ.
1336
La première annonce de l’Eucharistie a divisé les disciples, tout
comme l’annonce de la Passion les a scandalisés : " Ce
langage-là est trop fort ! Qui peut l’écouter ? " (Jn 6, 60). L’Eucharistie et la croix sont des pierres
d’achoppement. C’est le même mystère, et il ne cesse d’être occasion de
division. " Voulez-vous partir, vous aussi ? " (Jn 6, 67) : Cette question du Seigneur retentit à
travers les âges, invitation de son amour à découvrir que c’est Lui seul qui
a " les paroles de la vie éternelle " (Jn 6, 68) et qu’accueillir dans la foi le don de son
Eucharistie, c’est l’accueillir Lui-même.
 L’institution de
l’Eucharistie. L’institution de
l’Eucharistie.
Haut de page.
1337
Le Seigneur,
ayant aimé les siens, les aima jusqu’à la fin. Sachant que l’heure était
venue de partir de ce monde pour retourner à son Père, au cours d’un repas,
il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l’amour (cf. Jn 13, 1-17). Pour leur laisser un gage de cet amour,
pour ne jamais s’éloigner des siens et pour les rendre participants de sa
Pâque, il institua l’Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa
résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu’à son retour,
" les établissant alors prêtres du Nouveau Testament "
(Cc. Trente : DS 1740).
1338
Les trois évangiles synoptiques et S. Paul nous ont transmis le récit
de l’institution de l’Eucharistie ; de son côté, S. Jean rapporte les
paroles de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, paroles qui préparent
l’institution de l’Eucharistie : Le Christ se désigne comme le pain de
vie, descendu du ciel (cf. Jn 6).
1339
Jésus a choisi le temps de la Pâque pour accomplir ce qu’il avait
annoncé à Capharnaüm : donner à ses disciples son Corps et son
Sang :
Vint le jour des Azymes, où l’on
devait immoler la pâque. [Jésus] envoya alors Pierre et Jean : ‘Allez
dit-il, nous préparer la Pâque, que nous la mangions’... Ils s’en allèrent
donc ... et préparèrent la Pâque. L’heure venue, il se mit à table avec ses
apôtres et leur dit : ‘J’ai désiré avec ardeur manger cette pâque avec
vous avant de souffrir ; car je vous le dis, je ne la mangerai jamais
plus jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse dans le Royaume de Dieu’ ... Puis,
prenant du pain et rendant grâces, il le rompit et le leur donna, en
disant : ‘Ceci est mon Corps, qui va être donné pour vous ; faites
ceci en mémoire de moi’. Il fit de même pour la coupe après le repas,
disant : ‘’Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang, qui va être
versé pour vous’ (Lc 22, 7-20 ; cf. Mt 26,
17-29 ; Mc 14, 12-25 ; 1 Co 11, 23-26).
1340
En célébrant
la dernière Cène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son
sens définitif à la pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par
sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipée
dans la Cène et célébrée dans l’Eucharistie qui accomplit la pâque juive et
anticipe la pâque finale de l’Église dans la gloire du Royaume.
 "Faites ceci en
mémoire de moi" "Faites ceci en
mémoire de moi"
Haut de page.
1341
Le
commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles
" jusqu’à ce qu’il vienne ", ne demande pas seulement de
se souvenir de Jésus et de ce qu’il a fait. Il vise la célébration
liturgique, par les apôtres et leurs successeurs, du mémorial du Christ, de
sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père.
1342
Dès le commencement l’Église a été fidèle à l’ordre du Seigneur. De
l’Église de Jérusalem il est dit :
Ils se montraient assidus à
l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières... Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur
nourriture avec joie et simplicité de cœur (Ac 2,
42. 46).
1343
C’était surtout
" le premier jour de la semaine ", c’est-à-dire le jour
du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se
réunissaient " pour rompre le pain " (Ac
20, 7). Depuis ces temps-là jusqu’à nos jours la célébration de l’Eucharistie
s’est perpétuée, de sorte qu’aujourd’hui nous la rencontrons partout dans
l’Église, avec la même structure fondamentale. Elle demeure le centre de la
vie de l’Église.
1344
Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de
Jésus " jusqu’à ce qu’Il vienne " (1 Co 11, 26), le
peuple de Dieu en pèlerinage " s’avance par la porte étroite de la
Croix " (AG 1) vers le banquet céleste, quand tous les élus
s’assiéront à la table du Royaume.
 IV. La célébration liturgique de l’eucharistie. IV. La célébration liturgique de l’eucharistie.
Haut de page.
 La messe de tous les
siècles. La messe de tous les
siècles.
1345
Dès le deuxième siècle, nous avons le témoignage de S. Justin le Martyr sur
les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Elles sont
restées les mêmes jusqu’à nos jours pour toutes les grandes familles
liturgiques. Voici ce qu’il écrit, vers 155, pour expliquer à l’empereur
païen Antonin le Pieux (138-161) ce que font les chrétiens :
[Le jour qu’on appelle jour du
soleil, a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent
la ville ou la campagne.
On lit les mémoires des Apôtres et les écrits des Prophètes, autant que le
temps le permet.
Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend
la parole pour inciter et exhorter à l’imitation de ces belles choses.
Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous
faisons des prières] pour nous-mêmes ... et pour tous les autres, où qu’ils
soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions et
fidèles aux commandements, pour obtenir ainsi le salut éternel.
Quand les prières sont terminées, nous nous
donnons un baiser les uns aux autres.
Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères
du pain et une coupe d’eau et de vin mélangés.
Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l’univers, par
le nom du Fils et du Saint-Esprit et il rend grâce (en grec : eucharistian)
longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ces dons.
Quand il a terminé les prières et les actions de
grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation en disant : Amen.
Lorsque celui qui préside a fait l’action de grâce et que le peuple a
répondu, ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui
sont présents du pain, du vin et de l’eau "eucharistiés"
et ils en apportent aux absents (S. Justin, apol.
1, 65 [le texte entre crochets est du chapitre 67]).
1346
La liturgie
de l’Eucharistie se déroule selon une structure fondamentale qui s’est
conservée à travers les siècles jusqu’à nous. Elle se déploie en deux grands
moments qui forment une unité foncière :
– le rassemblement, la liturgie de la Parole, avec les
lectures, l’homélie et la prière universelle ;
– la liturgie eucharistique, avec
la présentation du pain et du vin, l’action de grâce consécratoire
et la communion.
Liturgie de la Parole et liturgie eucharistique constituent ensemble
" un seul et même acte du culte " (SC 56) ; en
effet, la table dressée pour nous dans l’Eucharistie est à la fois celle de
la Parole de Dieu et celle du Corps du Seigneur (cf. DV 21).
1347
N’est-ce pas
là le mouvement même du repas pascal de Jésus ressuscité avec ses
disciples : chemin faisant, il leur expliquait les Écritures, puis, se
mettant à table avec eux, " il prit le pain, dit la bénédiction, le
rompit et le leur donna " (cf. Lc 24,
13-35) ?
 Le mouvement de la
célébration. Le mouvement de la
célébration.
Haut de page.
1348
Tous se rassemblent. Les chrétiens accourent dans un même lieu pour l’assemblée
eucharistique. À sa tête le Christ lui-même qui est l’acteur principal de
l’Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C’est Lui-même
qui préside invisiblement toute célébration eucharistique. C’est en Le
représentant que l’évêque ou le prêtre (agissant " in persona
Christi capitis ") préside l’assemblée,
prend la parole après les lectures, reçoit les offrandes et dit la prière
eucharistique. Tous ont leur
part active dans la célébration, chacun à sa manière : les lecteurs,
ceux qui apportent les offrandes, ceux qui donnent la communion, et le peuple
tout entier dont l’Amen manifeste la participation.
1349
La liturgie de la Parole
comporte "les écrits des prophètes", c’est-à-dire l’Ancien
Testament, et "les mémoires des apôtres", c’est-à-dire leurs
épîtres et les Évangiles ; après l’homélie qui exhorte à accueillir
cette Parole comme ce qu’elle est vraiment, Parole de Dieu (cf. 1 Th 2, 13),
et à la mettre en pratique, viennent les intercessions pour tous les hommes,
selon la parole de l’Apôtre : " Je recommande donc, avant
tout, qu’on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de
l’autorité " (1 Tm 2, 1-2).
1350
La présentation des oblats (l’offertoire) : on apporte alors, parfois en
procession, le pain et le vin à l’autel qui seront offerts par le prêtre au
nom du Christ dans le sacrifice eucharistique où ils deviendront le corps et
le sang de Celui-ci. C’est le geste même du Christ à la Dernière Cène,
" prenant du pain et une coupe ". " Cette
oblation, l’Église seule l’offre, pure, au Créateur, en lui offrant avec
action de grâce ce qui provient de sa création " (S. Irénée, hær. 4, 18, 4 ; cf. Ml 1, 11). La présentation des
oblats à l’autel assume le geste de Melchisédech et confie les dons du
créateur entre les mains du Christ. C’est Lui qui, dans Son sacrifice, mène à
la perfection toutes les tentatives humaines d’offrir des sacrifices.
1351
Dès le début, les chrétiens apportent, avec le pain et le vin pour
l’Eucharistie, leurs dons pour le partage avec ceux qui sont dans le besoin.
Cette coutume de la collecte
(cf. 1 Co 16, 1), toujours actuelle, s’inspire de l’exemple du Christ qui s’est
fait pauvre pour nous enrichir (cf. 2 Co 8, 9) :
Ceux qui sont riches et qui
veulent, donnent, chacun selon ce qu’il s’est lui-même imposé ; ce qui
est recueilli est remis à celui qui préside et lui, il assiste les orphelins
et les veuves, ceux que la maladie ou toute autre cause prive de ressources,
les prisonniers, les immigrés et, en un mot, il secourt tous ceux qui sont
dans le besoin (S. Justin, apol. 1, 67, 6).
1352
L’anaphore : Avec la prière
eucharistique, prière d’action de grâce et de consécration, nous arrivons au
cœur et au sommet de la célébration :
Dans la préface l’Église rend grâce au Père, par le Christ, dans
l’Esprit Saint, pour toutes ses œuvres, pour la création, la rédemption et la
sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante
que l’Église céleste, les anges et tous les saints, chantent au Dieu trois
fois Saint.
1353
Dans l’épiclèse elle demande au Père
d’envoyer son Esprit Saint (ou la puissance de sa bénédiction : cf. MR,
Canon Romain 90) sur le pain et le vin, afin qu’ils deviennent, par sa
puissance, le Corps et le Sang de Jésus-Christ, et que ceux qui prennent part
à l’Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit (certaines traditions
liturgiques placent l’épiclèse après l’anamnèse).
Dans le récit de l’institution
la force des paroles et de l’action du Christ, et la puissance de l’Esprit
Saint, rendent sacramentellement présents sous les espèces du pain et du vin
son Corps et son Sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour
toutes.
1354
Dans l’anamnèse qui
suit, l’Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour
glorieux du Christ Jésus ; elle présente au Père l’offrande de son Fils
qui nous réconcilie avec Lui.
Dans les intercessions, l’Église
exprime que l’Eucharistie est célébrée en communion avec toute l’Église du
ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et dans la communion avec
les pasteurs de l’Église, le Pape, l’évêque du diocèse, son presbyterium et
ses diacres, et tous les évêques du monde entier avec leurs églises.
1355
Dans la communion, précédée
de la prière du Seigneur et de la fraction du pain, les fidèles reçoivent
" le pain du ciel " et " la coupe du
salut ", le Corps et le Sang du Christ qui s’est livré
" pour la vie du monde " (Jn 6,
51) :
Parce que ce pain et ce vin ont
été, selon l’expression ancienne, "eucharistiés",
" nous appelons cette nourriture Eucharistie et personne ne peut y prendre part s’il ne croit
pas à la vérité de ce qu’on enseigne chez nous, s’il n’a reçu le bain pour la
rémission des péchés et la nouvelle naissance et s’il ne vit selon les
préceptes du Christ " (S. Justin, apol.
1, 66, 1-2).
 V. Le sacrifice sacramentel : action de
grâce, mémorial, présence. V. Le sacrifice sacramentel : action de
grâce, mémorial, présence.
Haut de page.
1356
Si les chrétiens célèbrent l’Eucharistie depuis les origines, et sous une
forme qui, dans sa substance, n’a pas changé à travers la grande diversité
des âges et des liturgies, c’est parce que nous nous savons liés par l’ordre
du Seigneur, donné la veille de sa passion : " faites ceci en
mémoire de moi " (1 Co 11, 24-25).
1357
Cet ordre du Seigneur, nous l’accomplissons en célébrant le mémorial de son sacrifice. Ce
faisant, nous offrons au Père ce qu’il nous a Lui-même
donné : les dons de sa création, le pain et le vin, devenus, par la
puissance de l’Esprit Saint et par les paroles du Christ, le Corps et le Sang
du Christ : le Christ est ainsi rendu réellement et mystérieusement présent.
1358
Il nous faut donc considérer l’Eucharistie :
– comme action de grâce et louange au Père,
– comme mémorial sacrificiel du Christ et de son Corps,
– comme présence du Christ par la puissance de sa Parole et de son Esprit.
 L’action de grâce et la
louange au Père. L’action de grâce et la
louange au Père.
Haut de page.
1359
L’Eucharistie, sacrement de notre salut accompli par le Christ sur la croix,
est aussi un sacrifice de louange en action de grâce pour l’œuvre de la
création. Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée par Dieu
est présentée au Père à travers la mort et la résurrection du Christ. Par le
Christ, l’Église peut offrir le sacrifice de louange en action de grâce pour
tout ce que Dieu a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans
l’humanité.
1360
L’Eucharistie est un sacrifice d’action de grâce au Père, une
bénédiction par laquelle l’Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous
ses bienfaits, pour tout ce qu’il a accompli par la création, la rédemption
et la sanctification. Eucharistie signifie d’abord : action de grâce.
1361
L’Eucharistie est aussi le sacrifice de louange, par lequel l’Église
chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce sacrifice de louange
n’est possible qu’à travers le Christ : Il unit les fidèles à sa
personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que le sacrifice de
louange au Père est offert par le
Christ et avec lui pour être
accepté en lui.
 Le mémorial sacrificiel du
Christ et de son Corps, l’Église. Le mémorial sacrificiel du
Christ et de son Corps, l’Église.
Haut de page.
1362
L’Eucharistie
est le mémorial de la Pâque du Christ, l’actualisation et l’offrande
sacramentelle de son unique sacrifice, dans la liturgie de l’Église qui est
son Corps. Dans toutes les prières eucharistiques nous trouvons, après les
paroles de l’institution, une prière appelée anamnèse ou mémorial.
1363
Dans le sens de l’Écriture Sainte le mémorial n’est pas seulement le souvenir des événements du
passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les
hommes (cf. Ex 13, 3). Dans la célébration liturgique de ces événements, ils
deviennent d’une certaine façon présents et actuels.
C’est de cette manière qu’Israël comprend sa libération d’Égypte :
chaque fois qu’est célébrée la pâque, les événements de l’Exode sont rendus
présents à la mémoire des croyants afin qu’ils y conforment leur vie.
1364
Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand
l’Église célèbre l’Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ, et
celle-ci devient présente : le sacrifice que le Christ a offert une fois
pour toutes sur la Croix demeure toujours actuel (cf. He 7, 25-27) :
" Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ
notre pâque a été immolé se célèbre sur l’autel, l’œuvre de notre rédemption
s’opère " (LG 3).
1365
Parce qu’elle est mémorial de la Pâque du Christ, l’Eucharistie est aussi un sacrifice. Le
caractère sacrificiel de l’Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes
de l’institution : " Ceci est mon Corps qui va être donné pour
vous " et " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
Sang, qui va être versé pour vous " (Lc
22, 19-20). Dans l’Eucharistie le Christ donne ce corps même qu’il a livré
pour nous sur la croix, le sang même qu’il a "répandu pour une multitude
en rémission des péchés" (Mt 26, 28).
1366
L’Eucharistie est donc un sacrifice parce qu’elle représente (rend présent) le
sacrifice de la croix, parce qu’elle en est le mémorial et parce qu’elle en applique le fruit :
[Le Christ] notre Dieu et
Seigneur, s’offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en
intercesseur sur l’autel de la Croix, afin de réaliser pour eux (les hommes)
une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à
son sacerdoce (He 7, 24. 27), à la dernière Cène, " la nuit où il
fut livré " (1 Co 11, 13), il voulait laisser à l’Église, son
épouse bien-aimée, un sacrifice visible (comme le réclame la nature humaine),
où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s’accomplir une unique
fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu’à la fin des siècles
(1 Co 11, 23) et dont la vertu salutaire s’appliquerait à la rédemption des
péchés que nous commettons chaque jour (Cc. Trente : DS 1740).
1367
Le sacrifice
du Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice : " C’est une seule et même
victime, c’est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui
s’est offert lui-même alors sur la Croix. Seule la manière d’offrir diffère "
(Cc. Trente, sess. 22a, Doctrina de ss. Missae
sacrificio, c. 2 : DS 1743).
" Et puisque dans ce divin sacrifice qui s’accomplit à la messe, ce
même Christ, qui s’est offert lui-même une fois de manière sanglante sur
l’autel de la Croix, est contenu et immolé de manière non sanglante, ce
sacrifice est vraiment propitiatoire " (ibid.).
1368
L’Eucharistie est également le
sacrifice de l’Église. L’Église, qui est le Corps du Christ, participe à
l’offrande de son Chef. Avec Lui, elle est offerte elle-même tout entière.
Elle s’unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans
l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres
de son Corps. La vie des fidèles, leur louange, leur souffrance, leur prière,
leur travail, sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et
acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur
l’autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d’être
unis à son offrande.
Dans les catacombes, l’Église est souvent représentée comme une femme en
prière, les bras largement ouverts en attitude d’orante. Comme le Christ qui
a étendu les bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s’offre et
intercède pour tous les hommes.
1369
Toute l’Église est unie à l’offrande et à l’intercession du Christ.
Chargé du ministère de Pierre dans l’Église, le Pape est associé à toute célébration de l’Eucharistie où il
est nommé comme signe et serviteur de l’unité de l’Église Universelle. L’évêque du lieu est toujours
responsable de l’eucharistie, même lorsqu’elle est présidée par un prêtre ; son nom y est
prononcé pour signifier sa présidence de l’Église particulière, au milieu du
presbyterium et avec l’assistance des diacres.
La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle et avec
elle, offrent le sacrifice eucharistique :
Que cette eucharistie seule soit
regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l’évêque ou de
celui qu’il en a chargé (S. Ignace d’Antioche, Smyrn.
8, 1).
C’est par le ministère des prêtres que se
consomme le sacrifice spirituel des chrétiens, en union avec le sacrifice du
Christ, unique Médiateur, offert au nom de toute l’Église dans l’Eucharistie
par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu’à
ce que vienne le Seigneur lui-même (PO 2).
1370
À l’offrande du Christ s’unissent non seulement les membres qui sont
encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel : C’est en communion avec la très
Sainte Vierge Marie et en faisant mémoire d’elle, ainsi que de tous les
saints et toutes les saintes, que l’Église offre le sacrifice eucharistique.
Dans l’Eucharistie l’Église, avec Marie, est comme au pied de la Croix, unie
à l’offrande et à l’intercession du Christ.
1371
Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts " qui sont morts dans le
Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés " (Cc.
Trente : DS 1743), pour qu’ils puissent entrer dans la lumière et la
paix du Christ :
Enterrez ce corps n’importe
où ! Ne vous troublez pas pour lui d’aucun souci ! Tout ce que je
vous demande, c’est de vous souvenir de moi à l’autel du Seigneur où que vous
soyez " (S. Monique, avant sa mort, à S. Augustin et son
frère ; conf. 9, 11, 27).
Ensuite, nous prions [dans l’anaphore] pour
les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se
sont endormis avant nous, en croyant qu’il y aura très grand profit pour les
âmes, en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis que se trouve
présente la sainte et si redoutable victime... En présentant à Dieu nos
supplications pour ceux qui se sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous ...
présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice, pour eux et
pour nous, le Dieu ami des hommes (S. Cyrille de Jérusalem, catech. myst. 5, 9. 10 :
PG 33, 1116B-1117A).
1372
S. Augustin a admirablement résumé cette doctrine qui nous incite à
une participation de plus en plus complète au sacrifice de notre Rédempteur
que nous célébrons dans l’Eucharistie :
Cette cité rachetée tout entière,
c’est-à-dire l’assemblée et la société des saints, est offerte à Dieu comme
un sacrifice universel par le Grand Prêtre qui, sous la forme d’esclave, est
allé jusqu’à s’offrir pour nous dans sa passion, pour faire de nous le corps
d’un si grand Chef ... Tel est le sacrifice des chrétiens :
" à plusieurs, n’être qu’un seul corps dans le Christ " (Rm 12, 5). Et ce sacrifice, l’Église ne cesse de le
reproduire dans le Sacrement de l’autel bien connu des fidèles, où il lui est
montré que dans ce qu’elle offre, elle est elle-même offerte (S. Augustin,
civ. 10, 6).
 La présence du Christ par
la puissance de sa Parole et de l’Esprit Saint. La présence du Christ par
la puissance de sa Parole et de l’Esprit Saint.
Haut de page.
1373
"Le
Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu,
qui intercède pour nous" (Rm 8, 34), est
présent de multiples manières à son Église (cf. LG 48) : dans sa Parole,
dans la prière de son Église, " là où deux ou trois sont rassemblés
en mon nom " (Mt 18, 20), dans les pauvres, les malades, les
prisonniers (Mt 25, 31-46), dans ses sacrements dont il est l’auteur, dans le
sacrifice de la messe et en la personne du ministre. Mais " au plus haut point (il est présent) sous les espèces eucharistiques " (SC 7).
1374
Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est
unique. Il élève l’Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait
" comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle
tendent tous les sacrements " (S. Thomas d’A., s. th. 3, 73, 3).
Dans le très saint sacrement de l’Eucharistie sont " contenus vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang
conjointement avec l’âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et,
par conséquent, le Christ tout
entier " (Cc Trente : DS 1651). " Cette
présence, on la nomme ‘réelle’, non à titre exclusif, comme si les autres
présences n’étaient pas ‘réelles’, mais par excellence parce qu’elle est substantielle, et que par elle le
Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier " (MF 39).
1375
C’est par la conversion
du pain et du vin au le Corps et au Sang du Christ que le Christ devient
présent en ce sacrement. Les Pères de l’Église ont fermement affirmé la foi
de l’Église en l’efficacité de la Parole du Christ et de l’action de l’Esprit
Saint pour opérer cette conversion. Ainsi, S. Jean Chrysostome déclare :
Ce n’est pas l’homme qui fait que
les choses offertes deviennent Corps et Sang du Christ, mais le Christ
lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre, figure du Christ, prononce
ces paroles, mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon Corps, dit-il. Cette
parole transforme les choses offertes (prod. Jud. 1, 6 : PG 49, 380C).
Et saint Ambroise dit au sujet de cette
conversion :
Soyons bien persuadés que ceci
n’est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et
que la force de la bénédiction l’emporte sur celle de la nature, parce que
par la bénédiction la nature elle-même se trouve changée ... La parole du
Christ, qui a pu faire de rien ce qui n’existait pas, ne pourrait donc
changer les choses existantes en ce qu’elles n’étaient pas encore ? Car
ce n’est pas moins de donner aux choses leur nature première que de la leur
changer (myst. 9, 50. 52 : PL 16, 405-406).
1376
Le Concile de
Trente résume la foi catholique en déclarant : "Parce que le
Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu’il offrait sous l’espèce du pain
était vraiment son Corps, on a toujours eu dans l’Église cette conviction,
que déclare le saint Concile de nouveau : par la consécration du pain et
du vin s’opère le changement de toute la substance du pain en la substance du
Corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la
substance de son Sang ; ce changement, l’Église catholique l’a justement
et exactement appelé transsubstantiation"
(DS 1642).
1377
La présence eucharistique du Christ commence au moment de la
consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques
subsistent. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et
tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain
ne divise pas le Christ (cf. Cc. Trente : DS 1641).
1378
Le culte de l’Eucharistie. Dans la liturgie de la messe, nous
exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain
et du vin, entre autres, en fléchissant les genoux, ou en nous inclinant
profondément en signe d’adoration du Seigneur. " L’Église
catholique a rendu et continue de rendre ce culte d’adoration qui est dû au
sacrement de l’Eucharistie non seulement durant la messe, mais aussi en
dehors de sa célébration : en conservant avec le plus grand soin les
hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu’ils les vénèrent
avec solennité, en les portant en procession " (MF 56).
1379
La sainte réserve (tabernacle) était d’abord destinée à garder
dignement l’Eucharistie pour qu’elle puisse être portée aux malades et aux
absents en dehors de la messe. Par l’approfondissement de la foi en la
présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l’Église a pris conscience du
sens de l’adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces
eucharistiques. C’est pour cela que le tabernacle doit être placé à un
endroit particulièrement digne de l’église ; il doit être construit de
telle façon qu’il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du
Christ dans le saint sacrement.
1380
Il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à
son Église de cette façon unique. Puisque le Christ allait quitter les siens
sous sa forme visible, il voulait nous donner sa présence
sacramentelle ; puisqu’il allait s’offrir sur la Croix pour nous sauver,
il voulait que nous ayons le mémorial de l’amour dont il nous a aimés
" jusqu’à la fin " (Jn 13, 1),
jusqu’au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique il reste
mystérieusement au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et qui s’est
livré pour nous (cf. Ga 2, 20), et il le reste sous les signes qui expriment
et communiquent cet amour :
L’Église et le monde ont un grand
besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de
l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer dans l’adoration,
dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et
les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration (Jean Paul II, l.
" Dominicæ cenæ "
3).
1381
"La
présence du véritable Corps du Christ et du véritable Sang du Christ dans ce
sacrement, ‘on ne l’apprend point par les sens, dit S. Thomas, mais par la foi seule, laquelle s’appuie
sur l’autorité de Dieu’. C’est pourquoi, commentant le texte de S. Luc, 22,
19 : ‘Ceci est mon Corps qui sera livré pour vous’, saint Cyrille
d’Alexandrie (Lc. 22, 19 : PG 72, 921B)
déclare : ‘Ne va pas te demander si c’est vrai, mais accueille plutôt
avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la Vérité, ne ment
pas’ " (Thomas d’A., s. th. 3, 75, 1 cité par Paul VI, MF
18) :
|
Adoro te devote, latens Deitas,
Quæ sub his figuris vere latitas :
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te contemplans totum
deficit.
|
Je
T’adore profondément, divinité cachée,
vraiment présente sous ces apparences ;
à Toi mon cœur se soumet tout entier
parce qu’à Te contempler, tout entier il défaille
|
|
Visus, gustus, tactus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur :
Credo quidquid dixit Dei Filius :
Nil hoc Veritatis verbo
verius.
|
La vue,
le goût, le toucher ne T’atteignent pas :
à ce qu’on entend dire seulement il faut se fier ;
je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu ;
rien de plus vrai que cette parole de la Vérité.
|
 VI. Le banquet pascal. VI. Le banquet pascal.
Haut de page.
1382
La messe est
à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue
le sacrifice de la croix, et le banquet sacré de la communion au Corps et au
Sang du Seigneur. Mais la célébration du sacrifice eucharistique est toute
orientée vers l’union intime des fidèles au Christ par la communion.
Communier, c’est recevoir le Christ lui-même qui s’est offert pour nous.
1383
L’autel, autour duquel
l’Église est rassemblée dans la célébration de l’Eucharistie, représente les
deux aspects d’un même mystère : l’autel du sacrifice et la table du
Seigneur, et ceci d’autant plus que l’autel chrétien est le symbole du Christ
lui-même, présent au milieu de l’assemblée de ses fidèles, à la fois comme la
victime offerte pour notre réconciliation et comme aliment céleste qui se
donne à nous. " Qu’est-ce en effet l’autel du Christ sinon l’image
du Corps du Christ ? " – dit S. Ambroise (sacr.
5, 7 : PL 16, 447C), et ailleurs : " L’autel représente
le Corps [du Christ], et le Corps du Christ est sur l’autel " (sacr. 4, 7 : PL 16, 437D). La liturgie exprime cette
unité du sacrifice et de la communion dans de nombreuses prières. Ainsi,
l’Église de Rome prie dans son anaphore :
|
Supplices
te rogamus, omnipotens
Deus, jube hæc perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinæ majestatis : ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui Corpus et Sanguinem sumpserimus, omni benedictione
cælesti et gratia repleamur.
|
Nous
T’en supplions, Dieu Tout-Puissant : que [cette offrande] soit portée
par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu’en
recevant ici, par notre communion à cet autel, le corps et le sang de ton
Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
|
 "Prenez et mangez en
tous" : la communion. "Prenez et mangez en
tous" : la communion.
Haut de page.
1384
Le Seigneur
nous adresse une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de
l’Eucharistie : " En vérité, en vérité, je vous le dis, si
vous ne mangez la Chair du Fils de l’homme et ne buvez son Sang, vous n’aurez
pas la vie en vous " (Jn 6, 53).
1385
Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. S. Paul exhorte
à un examen de conscience : " Quiconque mange ce pain ou boit
cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du
Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’il mange alors de ce pain
et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa
propre condamnation, s’il n’y discerne le Corps " (1 Co 11, 27-29).
Celui qui est conscient d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la
Réconciliation avant d’accéder à la communion.
1386
Devant la grandeur de ce sacrement, le fidèle ne peut que reprendre
humblement et avec une foi ardente la parole du Centurion (cf. Mt 8,
8) : " Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum
meum, sed tantum dic verbum,
et sanabitur anima mea "
(" Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis
seulement une parole et je serai guéri "). Et dans la Divine
Liturgie de S. Jean Chrysostome, les fidèles prient dans le même
esprit :
À ta cène mystique fais-moi
communier aujourd’hui, ô Fils de Dieu. Car je ne dirai pas le Secret à tes
ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas. Mais, comme le larron, je te
crie : Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume.
1387
Pour se
préparer convenablement à recevoir ce sacrement, les fidèles observeront le
jeûne prescrit dans leur Église (cf. CIC, can.
919). L’attitude corporelle (gestes, vêtement) traduira le respect, la
solennité, la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte.
1388
Il est conforme au sens même de l’Eucharistie que les fidèles, s’ils
ont les dispositions requises (cf. CIC 916), communient quand ils participent à la messe (Dans la même
journée, les fidèles peuvent recevoir la très Sainte Communion deux fois, et
seulement deux fois [cf. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici authentice interpretando, Responsa ad proposita dubia, 1 : AAS 76 (1984), p. 746]) :
" Il est vivement recommandé aux fidèles de participer à la Messe
de façon plus parfaite en recevant aussi, après la communion du prêtre, le
corps du Seigneur du même sacrifice " (SC 55).
1389
L’Église fait obligation aux fidèles de participer les dimanches et
les jours de fête à la divine liturgie (cf. OE 15) et de recevoir au moins
une fois par an l’Eucharistie, si possible au temps pascal (cf. CIC, can. 920), préparés par le sacrement de la
Réconciliation. Mais l’Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la
sainte Eucharistie les dimanches et les jours de fête, ou plus souvent
encore, même tous les jours.
1390
Grâce à la présence sacramentelle du Christ sous chacune des espèces,
la communion à la seule espèce du pain permet de recevoir tout le fruit de
grâce de l’Eucharistie. Pour des raisons pastorales, cette manière de
communier s’est légitimement établie comme la plus habituelle dans le rite
latin. " La sainte communion réalise plus pleinement sa forme de
signe lorsqu’elle se fait sous les deux espèces. Car, sous cette forme, le
signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière "
(IGMR 240). C’est la forme habituelle de communier dans les rites orientaux.
 Les fruits de la
communion. Les fruits de la
communion.
Haut de page.
1391
La communion accroît notre union au Christ. Recevoir l’Eucharistie dans la communion
porte comme fruit principal l’union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit
en effet : "Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et
moi en lui" (Jn 6, 56). La vie en Christ
trouve son fondement dans le banquet eucharistique : "De même
qu’envoyé par le Père, qui est vivant, moi, je vis par le Père, de même,
celui qui me mange, vivra, lui aussi, par moi" (Jn
6, 57) :
Lorsque dans les fêtes du
Seigneur les fidèles reçoivent le Corps du Fils, ils proclament les uns aux
autres la Bonne Nouvelle que les arrhes de la vie
sont donnés, comme lorsque l’ange dit à Marie de Magdala :
" Le Christ est ressuscité ! " Voici que maintenant
aussi la vie et la résurrection sont conférées à celui qui reçoit le Christ (Fanqîth, Office syriaque d’Antioche, volume 1, Commun,
237a-b).
1392 Ce que l’aliment matériel produit dans notre vie corporelle, la
communion le réalise de façon admirable dans notre vie spirituelle. La
communion à la Chair du Christ ressuscité, " vivifiée par l’Esprit
Saint et vivifiante " (PO 5), conserve, accroît et renouvelle la
vie de grâce reçue au Baptême. Cette croissance de la vie chrétienne a besoin
d’être nourrie par la communion eucharistique, pain de notre pèlerinage,
jusqu’au moment de la mort, où il nous sera donné comme viatique.
1393
La communion nous sépare du péché. Le Corps du Christ que nous
recevons dans la communion est "livré pour nous", et le Sang que
nous buvons, est "versé pour la multitude en rémission des péchés".
C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous
purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés
futurs :
"Chaque fois que nous le
recevons, nous annonçons la mort du Seigneur" (1 Co 11, 26). Si nous
annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons la rémission des péchés. Si,
chaque fois que son Sang est répandu, il est répandu pour la rémission des
péchés, je dois toujours le recevoir, pour que toujours il remette mes
péchés. Moi qui pèche toujours, je dois avoir toujours un remède (S.
Ambroise, sacr. 4, 28 : PL 16, 446A).
1394
Comme la
nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l’Eucharistie
fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s’affaiblir ;
et cette charité vivifiée efface les
péchés véniels (cf. Cc. Trente : DS 1638). En se donnant à nous,
le Christ ravive notre amour et nous rend capables de rompre les attachements
désordonnés aux créatures et de nous enraciner en Lui :
Puisque le Christ est mort pour
nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du
sacrifice, nous demandons que l’amour nous soit accordé par la venue du
Saint-Esprit ; nous prions humblement qu’en vertu de cet amour, par
lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce
du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous,
et être nous-mêmes crucifiés pour le monde... Ayant reçu le don de l’amour,
mourons au péché et vivons pour Dieu (S. Fulgence de Ruspe,
Fab. 28, 16-19 : CCL 19A, 813-814 : LH,
sem. 28, lundi, off. lect.).
1395
Par la même
charité qu’elle allume en nous, l’Eucharistie nous préserve des péchés mortels futurs. Plus nous participons à la
vie du Christ et plus nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile
de rompre avec Lui par le péché mortel. L’Eucharistie n’est pas ordonnée au
pardon des péchés mortels. Ceci est propre au sacrement de la Réconciliation.
Le propre de l’Eucharistie est d’être le sacrement de ceux qui sont dans la
pleine communion de l’Église.
1396
L’unité du Corps mystique : l’Eucharistie fait l’Église. Ceux qui
reçoivent l’Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le
Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps : l’Église. La
communion renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l’Église
déjà réalisée par le Baptême. Dans le Baptême nous avons été appelés à ne
faire qu’un seul corps (cf. 1 Co 12, 13). L’Eucharistie réalise cet
appel : " La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle
pas communion au Sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas
communion au Corps du Christ ? Puisqu’il n’y a qu’un pain, à nous tous
nous ne formons qu’un corps, car tous nous avons part à ce pain
unique " (1 Co 10, 16-17) :
Si vous êtes le corps du Christ
et ses membres, c’est votre sacrement qui est placé sur la table du Seigneur,
vous recevez votre sacrement. Vous répondez " Amen "
(" oui, c’est vrai ! ") à ce que vous recevez, et
vous y souscrivez en répondant. Tu entends ce mot : " le Corps
du Christ " et tu réponds : " Amen ". Sois
donc un membre du Christ pour que soit vrai ton Amen (S. Augustin, serm. 272 : PL 38, 1247).
1397
L’Eucharistie engage envers les pauvres : Pour recevoir dans la vérité le Corps et le Sang du
Christ livrés pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus
pauvres, Ses frères (cf. Mt 25, 40) :
Tu as goûté au sang du Seigneur
et tu ne reconnais pas même ton frère. Tu déshonores cette table même, en ne
jugeant pas digne de partager ta nourriture celui qui a été jugé digne de
prendre part à cette table. Dieu t’a libéré de tous tes péchés et t’y a
invité. Et toi, pas même alors, tu n’es devenu plus miséricordieux (S. Jean
Chrysostome, hom. in 1
Cor. 27, 4 : PG 61, 229-230).
1398
L’Eucharistie et l’unité des chrétiens. Devant la grandeur de ce mystère, S. Augustin s’écrie :
" O sacrement de la
piété ! O signe de l’unité ! O lien de la charité ! "
(ev. Jo. 26, 6, 13 ; cf. SC 47). D’autant plus
douloureuses se font ressentir les divisions de l’Église qui rompent la
commune participation à la table du Seigneur, d’autant plus pressantes sont
les prières au Seigneur pour que reviennent les jours de l’unité complète de
tous ceux qui croient en Lui.
1399
Les Églises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec
l’Église catholique célèbrent l’Eucharistie avec un grand amour.
" Ces Églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements, –
principalement, en vertu de la succession apostolique : le Sacerdoce et
l’Eucharistie, – qui les unissent intimement à nous " (UR 15). Une
certaine communion in sacris,
donc dans l’Eucharistie, est " non seulement possible, mais même
recommandée, lors de circonstances favorables et avec l’approbation de
l’autorité ecclésiastique " (UR 15 ; cf. CIC, can. 844, § 3).
1400
Les communautés ecclésiales issues de la Réforme, séparées de l’Église
catholique, "en raison surtout de l’absence du sacrement de l’Ordre,
n’ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère
eucharistique" (UR 22). C’est pour cette raison que, pour l’Église
catholique, l’intercommunion eucharistique avec ces communautés n’est pas
possible. Cependant, ces communautés ecclésiales, " lorsqu’elles
font mémoire dans la sainte Cène de la mort et de la résurrection du
Seigneur, professent que la vie consiste dans la communion au Christ et
attendent son retour glorieux " (UR 22).
1401
Lorsqu’une nécessité grave se fait pressente, selon le jugement de
l’ordinaire, les ministres catholiques peuvent donner les sacrements
(Eucharistie, pénitence, onction des malades) aux autres chrétiens qui ne
sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, mais qui les demandent
de leur plein gré : il faut alors qu’ils manifestent la foi catholique
concernant ces sacrements et qu’ils se trouvent dans les dispositions requises
(cf. CIC, can. 844, § 4).
 VII. L’eucharistie – "pignus futurae gloriae". VII. L’eucharistie – "pignus futurae gloriae".
Haut de page.
1402
Dans une antique prière, l’Église acclame le mystère de l’Eucharistie :
" O sacrum convivium in
quo Christus sumitur. Recolitur
memoria passionis eius ; mens impletur gratia et futuræ gloriæ nobis pignus datur "
(O banquet sacré où le Christ est notre aliment, où est ravivé le souvenir de
sa passion, où la grâce emplit notre âme, où nous est donné le gage de la vie
à venir). Si l’Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Seigneur, si par
notre communion à l’autel, nous sommes comblés " de toute
bénédiction céleste et grâce " (MR, Canon Romain 96 :
" Supplices te rogamus "),
l’Eucharistie est aussi l’anticipation de la gloire céleste.
1403
Lors de la dernière cène, le Seigneur a lui-même tourné le regard de
ses disciples vers l’accomplissement de la Pâque dans le royaume de
Dieu : " Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce
produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans
le Royaume de mon Père " (Mt 26, 29 ; cf. Lc
22, 18 ; Mc 14, 25). Chaque fois que l’Église célèbre l’Eucharistie,
elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers
" Celui qui vient " (Ap 1, 4).
Dans sa prière, elle appelle sa venue : "Marana tha"
(1 Co 16, 22), "Viens, Seigneur Jésus" (Ap
22, 20), "Que ta grâce vienne et que ce monde passe !" (Didaché 10, 6).
1404
L’Église sait que, dès maintenant, le Seigneur vient dans son
Eucharistie, et qu’il est là, au milieu de nous. Cependant, cette présence
est voilée. C’est pour cela que nous célébrons l’Eucharistie " expectantes beatam
spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi " (en attendant la
bienheureuse espérance et l’avénement de notre
Sauveur Jésus-Christ – Embolisme après le Notre Père ; cf. Tt 2, 13), en
demandant "d’être comblés de ta gloire, dans ton Royaume, tous ensemble
et pour l’éternité, quand Tu essuieras toute larme de nos yeux ; en Te
voyant, Toi notre Dieu, tel que Tu es, nous Te serons semblables
éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ, notre
Seigneur" (MR, prière eucharistique III, 116 : prière pour les
défunts).
1405
De cette grande espérance, celle des cieux nouveaux et de la terre
nouvelle en lesquels habitera la justice (cf. 2 P 3, 13), nous n’avons pas de
gage plus sûr, de signe plus manifeste que l’Eucharistie. En effet, chaque
fois qu’est célébré ce mystère, " l’œuvre de notre rédemption
s’opère " (LG 3) et nous " rompons un même pain qui est
remède d’immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en
Jésus-Christ pour toujours " (S. Ignace d’Antioche, Eph. 20, 2).
 En bref. En bref.
Haut de page.
1406
Jésus dit : " Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui
mangera ce pain vivra à jamais... Qui mange ma Chair et boit mon Sang a la
vie éternelle ... il demeure en moi et moi en lui " (Jn 6, 51. 54. 56).
1407
L’eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l’Église car en elle le
Christ associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange et
d’action de grâces offert une fois pour toutes sur la Croix à son Père ;
par ce sacrifice il répand les grâces du salut sur son Corps, qui est
l’Église.
1408
La célébration eucharistique comporte toujours : la proclamation de la
Parole de Dieu, l’action de grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits,
surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et du vin et la
participation au banquet liturgique par la réception du Corps et du Sang du
Seigneur. Ces éléments constituent un seul et même acte de culte.
1409
L’Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ : c’est-à-dire de
l’œuvre du salut accomplie par la vie, la mort et la résurrection du Christ,
œuvre rendue présente par l’action liturgique.
1410
C’est le Christ lui-même, grand prêtre éternel de la nouvelle Alliance, qui,
agissant par le ministère des prêtres, offre le sacrifice eucharistique. Et
c’est encore le même Christ, réellement présent sous les espèces du pain et
du vin, qui est l’offrande du sacrifice eucharistique.
1411
Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l’Eucharistie et
consacrer le pain et le vin pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du
Seigneur.
1412
Les signes essentiels du sacrement eucharistique sont le pain de blé et le
vin du vignoble, sur lesquels est invoquée la bénédiction de l’Esprit Saint
et le prêtre prononce les paroles de la consécration dites par Jésus pendant
la dernière cène : "Ceci est mon corps livré pour vous ... Ceci est
la coupe de mon sang ..."
1413
Par la consécration s’opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le
Corps et le Sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le
Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et
substantielle, son Corps et son Sang, avec son âme et sa divinité (cf. Cc.
Trente : DS 1640 ; 1651).
1414
En tant que sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte en réparation des
péchés des vivants et des défunts, et pour obtenir de Dieu des bienfaits
spirituels ou temporels.
1415
Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion eucharistique doit se
trouver en état de grâce. Si quelqu’un a conscience d’avoir péché
mortellement, il ne doit pas accéder à l’Eucharistie sans avoir reçu
préalablement l’absolution dans le sacrement de Pénitence.
1416
La sainte Communion au Corps et au Sang du Christ accroît l’union du
communiant avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels et le préserve des
péchés graves. Puisque les liens de charité entre le communiant et le Christ
sont renforcés, la réception de ce sacrement renforce l’unité de l’Église,
Corps mystique du Christ.
1417
L’Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la sainte communion
quand ils participent à la célébration de l’Eucharistie ; elle leur en
fait obligation au moins une fois par an.
1418
Puisque le Christ lui-même est présent dans le Sacrement de l’Autel, il faut
l’honorer d’un culte d’adoration. " La visite au Très Saint
Sacrement est une preuve de gratitude, un signe d’amour et un devoir
d’adoration envers le Christ, notre Seigneur " (MF).
|