|
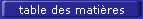
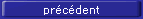

TEXTES
DE RÉFÉRENCE

Constitution
pastorale
GAUDIUM ET SPES
sur l'Église dans le monde
de ce temps
(Paul VI - 7 décembre 1965)

Lettre
encyclique
MATER ET MAGISTRA
sur le rôle social de l'Église
(Jean XXIII - 15 mai 1961)

Lettre
encyclique
CENTESIMUS ANNUS
pour le centenaire
de Rerum Novarum
(Jean-Paul II - 1er mai 1991)

Lettre encyclique
QUAGRAGESIMO ANNO
sur l’instauration
de l’ordre social
(Pie XI – 15 mai 1931)

Lettre
encyclique
PACEM IN TERRIS
sur la paix entre toutes les nations
(Jean XXIII -11 avril 1963)

Constitution
dogmatique
LUMEN GENTIUM
sur l'Église
(Paul VI -21 novembre 1964)

Lettre encyclique
IMMORTALE DEI
sur la constitution chrétienne
des États
(Léon XIII – 1er novembre 1885)

Lettre encyclique
DIUTURNUM ILLUD
sur l’origine du pouvoir civil
(Léon XIII – 28 juin 1881)

Lettre encyclique
SOLICITUDO REI SOCIALIS
sur la question sociale
(Jean-Paul II - 30 décembre 1987)

Lettre
encyclique
SUMMI PONTIFICATUS
sur l'unité du genre humain
(Pie XII - 20 octobre 1939)
|
Chapitre Deuxième :
La communauté humaine.
1877
La vocation de l’humanité est de
manifester l’image de Dieu et d’être transformée à l’image du Fils Unique du
Père. Cette vocation revêt une forme personnelle, puisque chacun est appelé à
entrer dans la béatitude divine ; elle concerne aussi l’ensemble de la
communauté humaine.
Article 1 :
La Personne et la Société.
Haut de page
I. Le caractère communautaire de la vocation humaine.
1878
Tous les hommes sont appelés à la même fin,
Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l’unité des
personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre
eux, dans la vérité et l’amour(1). L’amour du prochain est inséparable de l’amour pour
Dieu.
--------------------------------------
(1) cf. Gaudium et spes 24, § 3.
1879
La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue
pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par
l’échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses
frères, l’homme développe ses virtualités ; il répond ainsi à sa
vocation(1).
--------------------------------------
(1) cf. Gaudium et spes
25, § 1.
1880
Une société est un ensemble de personnes liées de façon
organique par un principe d’unité qui dépasse chacune d’elles. Assemblée à la
fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps : elle
recueille le passé et prépare l’avenir. Par elle, chaque homme est constitué
"héritier", reçoit des "talents" qui enrichissent son
identité et dont il doit développer les fruits(1). À juste titre,
chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect
aux autorités en charge du bien commun.
--------------------------------------
(1) cf. Luc 19, 16. 19.
1881
Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à
des règles spécifiques, mais "la personne humaine est et doit
être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions
sociales"(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
25, § 1.
1882
Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent
plus immédiatement à la nature de l’homme. Elles lui sont nécessaires. Afin
de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale, il faut encourager
la création d’associations et d’institutions d’élection "à buts
économiques, culturels, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels,
politiques, aussi bien à l’intérieur des communautés politiques que sur le
plan mondial"(1). Cette "socialisation" exprime
également la tendance naturelle qui pousse les humains à s’associer, en vue
d’atteindre des objectifs qui excèdent les capacités individuelles. Elle
développe les qualités de la personne, en particulier, son sens de
l’initiative et de la responsabilité. Elle aide à garantir ses droits(2).
--------------------------------------
(1) Mater et magistra 60 – (2) cf. Gaudium et spes 25, § 2 ; Centesimus annus 12.
1883
La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop
poussée de l’État peut menacer la liberté et l’initiative personnelles. La
doctrine de l’Église a élaboré le principe dit de subsidiarité. Selon
celui-ci, "une société d’ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la
vie interne d’une société d’ordre inférieur en lui enlevant ses compétences,
mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l’aider à coordonner
son action avec celle des autres éléments qui composent la société, en vue du
bien commun"(1)
--------------------------------------
(1) Centesimus annus
48 ; cf. Quadragesimo anno.
1884
Dieu n’a pas voulu retenir pour lui seul
l’exercice de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature les fonctions
qu’elle est capable d’exercer, selon les capacités de sa nature propre. Ce
mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale. Le comportement de
Dieu dans le gouvernement du monde, qui témoigne de si grands égards pour la
liberté humaine, devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les
communautés humaines. Ils ont à se comporter en ministres de la providence
divine.
1885
Le principe de subsidiarité s’oppose à toutes les formes de
collectivisme. Il trace les limites de l’intervention de l’État. Il vise à
harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés. Il tend à
instaurer un véritable ordre international.
Haut de page
II. La Conversion et la Société.
1886
La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Pour
atteindre ce but il faut que soit respectée la juste hiérarchie des valeurs
qui "subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions
intérieures et spirituelles"(1) :
La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d’ordre
spirituel. Elle est, en effet, échange de connaissances dans la lumière de la
vérité, exercice de droits et accomplissement des devoirs, émulation dans la
recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau en toutes
ses expressions légitimes, disposition permanente à communiquer à autrui le
meilleur de soi-même et aspiration commune à un constant enrichissement
spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter l’activité
culturelle, la vie économique, l’organisation sociale, les mouvements et les
régimes politiques, la législation et toutes les autres expressions de la vie
sociale dans sa continuelle évolution(2).
--------------------------------------
(1) Centesimus annus
36 – (2) Pacem in terris 35.
1887
L’inversion des moyens et des fins(1), qui aboutit à
donner valeur de fin ultime à ce qui n’est que moyen d’y concourir, ou à
considérer des personnes comme de purs moyens en vue d’un but, engendre des
structures injustes qui "rendent ardue et pratiquement impossible une
conduite chrétienne, conforme aux commandements du Divin Législateur"(2).
--------------------------------------
(1) cf. Centesimus annus
41 – (2) Pie XII,
discours 1er juin 1941.
1888
Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de
la personne et à l’exigence permanente de sa conversion intérieure,
afin d’obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La
priorité reconnue à la conversion du cœur n’élimine nullement, elle impose,
au contraire, l’obligation d’apporter aux institutions et aux conditions de
vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour
qu’elles se conforment aux normes de la justice, et favorisent le bien au
lieu d’y faire obstacle(1).
--------------------------------------
(1) cf. Lumen gentium 36.
1889
Sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient
"découvrir le sentier, souvent étroit, entre la lâcheté qui cède au mal
et la violence qui, croyant le combattre, l’aggrave"(1).
C’est le chemin de la charité, c’est-à-dire de l’amour de Dieu et du
prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle
respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de la justice et seule
nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi : "Qui
cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera"(2).
--------------------------------------
(1) Centesimus annus
25 – (2) Luc 17, 33.
En bref.
Haut de page
1890
Il existe une certaine ressemblance entre l’unité des personnes divines et la
fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux.
1891
Pour se développer en conformité avec sa nature, la personne humaine a
besoin de la vie sociale. Certaines sociétés, comme la famille et la cité,
correspondent plus immédiatement à la nature de l’homme.
1892
"La personne humaine est, et doit être le principe, le sujet et la
fin de toutes les institutions sociales" (Gaudium et spes 25, § 1).
1893
Il faut encourager une large participation à des associations et des
institutions d’élection.
1894
Selon le principe de subsidiarité, ni l’État ni aucune société plus vaste
ne doivent se substituer à l’initiative et à la responsabilité des personnes
et des corps intermédiaires.
1895
La société doit favoriser l’exercice des vertus, non y faire obstacle.
Une juste hiérarchie des valeurs doit l’inspirer.
1896
Là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la
conversion des cœurs et à la grâce de Dieu. La charité pousse à de justes
réformes. Il n’y a pas de solution à la question sociale en dehors de
l’Évangile (cf. Centesimus annus 3).
Article 2 : La participation à la vie sociale.
Haut de page
I. L’autorité.
1897
"À la vie en société manqueraient l’ordre et la fécondité sans la
présence d’hommes légitimement investis de l’autorité et qui assurent la
sauvegarde des institutions et pourvoient, dans une mesure suffisante, au
bien commun"(1).
On appelle "autorité" la qualité en vertu de laquelle des personnes
ou des institutions donnent des lois et des ordres à des hommes, et attendent
une obéissance de leur part.
--------------------------------------
(1) Pacem in terris 46.
1898
Toute communauté humaine a besoin d’une autorité qui la régisse(1).
Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine. Elle est nécessaire à
l’unité de la Cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien
commun de la société.
--------------------------------------
(1) cf. Immortale Dei et Diuturnum illud.
1899
L’autorité exigée par l’ordre moral émane de Dieu : "Que tout
homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a
d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi,
celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, et
les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes"(1).
--------------------------------------
(1) Romains 13, 1-2 ; cf. 1 Pierre 2, 13-17.
1900
Le devoir d’obéissance impose à tous de rendre à l’autorité les
honneurs qui lui sont dus, et d’entourer de respect et, selon leur mérite, de
gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge.
On trouve sous la plume du pape saint Clément de Rome la plus ancienne prière
de l’Église pour l’autorité politique(1) :
"Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité,
pour qu’ils exercent sans heurt la souveraineté que tu leur as remise. C’est
toi, Maître, céleste roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire,
honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leur
conseil, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux,
afin qu’en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que
tu leur as donné, ils te trouvent propice"(2).
--------------------------------------
(1) cf. déjà 1 Timothée 2, 1-2 - (2) Epistula ad corinthios,
61, 1-2.
1901
Si l’autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, "la
détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs
dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens"(1).
La diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu’ils
concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont
la nature est contraire à la loi naturelle, à l’ordre public et aux droits
fondamentaux des personnes, ne peuvent réaliser le bien commun des nations
auxquelles ils se sont imposés.
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
74, § 3.
1902
L’autorité ne tire pas d’elle-même sa légitimité morale. Elle ne doit
pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun comme
une "force morale fondée sur la liberté et le sens de la
responsabilité" (1) :
La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu’autant qu’elle se
conforme à la juste raison ; d’où il apparaît qu’elle tient sa vigueur
de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s’écarterait de la raison, il
faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de
loi ; elle serait plutôt une forme de violence (2).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
74, § 2 – (2) Saint
Thomas d’Aquin, Somme théologique,
1-2, 93, 3, ad 2
1903
L’autorité ne s’exerce légitimement que si elle recherche le bien
commun du groupe considéré et si, pour l’atteindre, elle emploie des moyens
moralement licites. S’il arrive aux dirigeants d’édicter des lois injustes ou
de prendre des mesures contraires à l’ordre moral, ces dispositions ne
sauraient obliger les consciences. "En pareil cas, l’autorité cesse
d’être elle-même et dégénère en oppression"(1).
--------------------------------------
(1) Pacem in terris 51.
1904
"Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d’autres
pouvoirs et par d’autres compétences qui le maintiennent dans de justes
limites. C’est là le principe de ‘l’État de droit’ dans lequel la
souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des
hommes"(1).
--------------------------------------
(1) Centesimus annus
44.
Haut de page
II. Le bien-commun.
1905
Conformément à la nature sociale de l’homme, le bien de chacun est
nécessairement en rapport avec le bien commun. Celui-ci ne peut être défini
qu’en référence à la personne humaine :
Ne vivez point isolés, retirés en vous-mêmes, comme si vous étiez déjà
justifiés, mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est de
l’intérêt commun(1).
--------------------------------------
(1) Barnabé, Epistula,
4, 10.
1906
Par bien-commun, il faut entendre "l’ensemble des conditions
sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres
d’atteindre leur perfection, d’une façon plus totale et plus aisée"(1).
Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de
chacun, et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de
l’autorité. Il comporte trois éléments essentiels :
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
26, § 1 ; cf. aussi Gaudium et spes 74, § 1.
1907
Il suppose, en premier lieu, le respect de la personne en tant
que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics se tenus de respecter
les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se
doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En
particulier, le bien commun réside dans les conditions d’exercice des
libertés naturelles qui sont indispensables à l’épanouissement de la vocation
humaine : "ainsi : droit d’agir selon la droite règle de sa
conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y
compris en matière religieuse"(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
26, § 2.
1908
En second lieu, le bien-commun demande le bien-être social et
le développement du groupe lui-même. Le développement est le résumé de
tous les devoirs sociaux. Certes, il revient à l’autorité d’arbitrer, au nom
du bien commun, entre les divers intérêts particuliers. Mais elle doit rendre
accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment
humaine : nourriture, vêtement, santé, travail, éducation et culture,
information convenable, droit de fonder une famille, etc.(1).
--------------------------------------
(1) cf. Gaudium et spes
26, § 2.
1909
Le bien-commun implique enfin la paix, c’est-à-dire la durée
et la sécurité d’un ordre juste. Il suppose donc que l’autorité assure, par
des moyens honnêtes, la sécurité de la société et celle de ses
membres. Il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective.
1910
Si chaque communauté humaine possède un bien commun qui lui permet de
se reconnaître en tant que telle, c’est dans la communauté politique
qu’on trouve sa réalisation la plus complète. Il revient à l’État de défendre
et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des
corps intermédiaires.
191
Les dépendances humaines s’intensifient. Ils s’étendent peu à peu à la terre
entière. L’unité de la famille humaine, rassemblant des êtres jouissant d’une
dignité naturelle égale, implique un bien commun universel. Celui-ci
appelle une organisation de la communauté des nations capable de
"pourvoir aux divers besoins des hommes, aussi bien dans le domaine de
la vie sociale (alimentation, santé, éducation ...), que pour faire face à
maintes circonstances particulières qui peuvent surgir ici ou là (par
exemple : l’accueil des réfugiés, l’assistance aux migrants et à leurs
familles ...)"(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
84, § 2.
1912
Le bien commun est toujours orienté vers le progrès des
personnes : "L’ordre des choses doit être subordonné à l’ordre des
personnes, et non l’inverse"(1). Cet ordre a pour base la
vérité, il s’édifie dans la justice, il est vivifié par l’amour.
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
27, § 3.
Haut de page
III. Responsabilité et Participation.
1913
La participation est l’engagement volontaire et généreux de la personne
dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon
la place qu’il occupe et le rôle qu’il joue, à promouvoir le bien commun. Ce
devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine.
1914
La participation se réalise d’abord dans la prise en charge des
domaines dont on assume la responsabilité personnelle : par le
soin apporté à l’éducation de sa famille, par la conscience dans son travail,
l’homme participe au bien d’autrui et de la société(1).
--------------------------------------
(1) cf. Centesimus annus
43.
1915
Les citoyens doivent autant que possible prendre une part active à la
vie publique. Les modalités de cette participation peuvent varier d’un
pays ou d’une culture à l’autre. "Il faut louer la façon d’agir des
nations où, dans une liberté authentique, le plus grand nombre possible de
citoyens participe aux affaires publiques" (1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
31, § 3.
1916
La participation de tous à la mise en œuvre du bien commun implique,
comme tout devoir éthique, une conversion sans cesse renouvelée des
partenaires sociaux. La fraude et autres subterfuges par lesquels certains
échappent aux contraintes de la loi et aux prescriptions du devoir social
doivent être fermement condamnées, parce qu’incompatibles avec les exigences
de la justice. Il faut s’occuper de l’essor des institutions qui améliorent
les conditions de la vie humaine(1).
--------------------------------------
(1) cf. Gaudium et spes
30, § 1.
1917
Il revient à ceux qui exercent la charge de l’autorité d’affermir les
valeurs qui attirent la confiance des membres du groupe et les incitent à se
mettre au service de leurs semblables. La participation commence par
l’éducation et la culture. "On peut légitimement penser que l’avenir est
entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des
raisons de vivre et d’espérer"(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
31, § 3.
En bref.
Haut de page
1918
"Il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies
par lui" (Romains 13, 1).
1919
Toute communauté humaine a besoin d’une autorité pour se maintenir et se
développer.
1920
"La communauté politique et l’autorité publique trouvent leur
fondement dans la nature humaine et relèvent par là d’un ordre fixé par Dieu"
(Gaudium et spes 74, § 3)
1921
L’autorité s’exerce d’une manière légitime si elle s’attache à la
poursuite du bien commun de la société. Pour l’atteindre, elle doit employer
des moyens moralement recevables.
1922
La diversité des régimes politiques est légitime, pourvu qu’ils
concourent au bien de la communauté.
1923
L’autorité politique doit se déployer dans les limites de l’ordre moral et
garantir les conditions d’exercice de la liberté.
1924
Le bien commun comprend "l’ensemble des conditions sociales qui
permettent aux groupes et aux personnes d’atteindre leur perfection, de manière
plus totale et plus aisée" (Gaudium et spes 26, § 1).
1925
Le bien commun comporte trois éléments essentiels : le respect et la
promotion des droits fondamentaux de la personne ; la prospérité ou le
développement des biens spirituels et temporels de la société ; la paix
et la sécurité du groupe et de ses membres.
1926
La dignité de la personne humaine implique la recherche du bien commun.
Chacun doit se préoccuper de susciter et de soutenir des institutions qui
améliorent les conditions de la vie humaine.
1927
Il revient à l’État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société
civile. Le bien commun de la famille humaine tout entière appelle une
organisation de la société internationale.
Article 3 :
La Justice Sociale.
Haut de page
1928
La société assure la justice sociale
lorsqu’elle réalise les conditions permettant aux associations et à chacun
d’obtenir ce qui leur est dû selon leur nature et leur vocation. La justice
sociale est en lien avec le bien commun et avec l’exercice de l’autorité.
I. Le respect de la personne humaine.
1929
La justice sociale ne peut être obtenue que dans le respect de la dignité
transcendante de l’homme. La personne représente le but ultime de la société,
qui lui est ordonnée :
La défense et la promotion de la dignité humaine nous ont été confiées par le
Créateur. Dans toutes les circonstances de l’histoire les hommes et les
femmes en sont rigoureusement responsables et débiteurs(1).
--------------------------------------
(1) Sollicitudo
rei socialis
47.
1930
Le respect de la personne humaine implique celui des droits qui découlent de
sa dignité de créature. Ces droits sont antérieurs à la société et s’imposent
à elle. Ils fondent la légitimité morale de toute autorité : en les
bafouant, ou en refusant de les reconnaître dans sa législation positive, une
société mine sa propre légitimité morale(1). Sans un tel respect, une
autorité ne peut que s’appuyer sur la force ou la violence pour obtenir
l’obéissance de ses sujets. Il revient à l’Église de rappeler ces droits à la
mémoire des hommes de bonne volonté, et de les distinguer des revendications
abusives ou fausses.
--------------------------------------
(1) cf. Pacem in terris 65.
1931
Le respect de la personne humaine passe par le respect du
principe : "Que chacun considère son prochain, sans aucune
exception, comme ‘un autre lui-même’. Qu’il tienne compte avant tout de son
existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement"(1).
Aucune législation ne saurait par elle-même faire disparaître les craintes,
les préjugés, les attitudes d’orgueil et d’égoïsme qui font obstacle à
l’établissement de sociétés vraiment fraternelles. Ces comportements ne
cessent qu’avec la charité qui trouve en chaque homme un "prochain",
un frère.
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
27, §1.
1932
Le devoir de se faire le prochain d’autrui et de le servir
activement se fait plus pressant encore lorsque celui-ci est plus démuni, en
quelque domaine que ce soit. "Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait"(1).
--------------------------------------
(1) Matthieu 25, 40.
1933
Ce même devoir s’étend à ceux qui pensent ou agissent différemment
de nous. L’enseignement du Christ va jusqu’à requérir le pardon des offenses.
Il étend le commandement de l’amour, qui est celui de la loi nouvelle, à tous
les ennemis(1). La libération dans l’esprit de l’Évangile est
incompatible avec la haine de l’ennemi en tant que personne mais non avec la
haine du mal qu’il fait en tant qu’ennemi.
--------------------------------------
(1) cf. Matthieu 5, 43-44.
Haut de page
II. Égalité et différences entre les hommes.
1934
Créés à l’image du Dieu unique, dotés d’une même âme raisonnable, tous les
hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ,
tous sont appelés à participer à la même béatitude divine : tous
jouissent donc d’une égale dignité.
1935
L’égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité
personnelle et les droits qui en découlent :
Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la
personne, qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la
condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée, comme
contraire au dessein de Dieu(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
29, § 2.
1936
En venant au monde, l’homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au
développement de sa vie, corporelle et spirituelle. Il a besoin des autres.
Des différences apparaissent liées à l’âge, aux capacités physiques, aux
aptitudes intellectuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu
bénéficier, à la distribution des richesses(1). Les "talents"
ne sont pas distribués également(2).
--------------------------------------
(1) cf. Gaudium et spes
29, § 2 – (2) cf.
Matthieu 25, 14-30 ; Luc 19, 11-27.
1937
Ces différences appartiennent au plan de Dieu, qui veut que chacun reçoive
d’autrui ce dont il a besoin, et que ceux qui disposent de "talents"
particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les
différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à
la bienveillance et au partage ; elles incitent les cultures à
s’enrichir les unes les autres : Je ne donne pas toutes les vertus
également à chacun ... Il en est plusieurs que je distribue de telle manière,
tantôt à l’un, tantôt à l’autre ... À l’un, c’est la charité ; à
l’autre, la justice ; à celui-ci l’humilité ; à celui-là, une foi
vive ... Quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie
humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité, et je n’ai pas
voulu que chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire pour que les
hommes aient ainsi l’occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns
envers les autres ... J’ai voulu qu’ils eussent besoin les uns des autres et
qu’ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités
qu’ils ont reçues de moi(1).
--------------------------------------
(1) S. Catherine de Sienne, Dialogi, 1, 6.
1938
Il existe aussi des inégalités iniques qui frappent des millions
d’hommes et de femmes. Elles sont en contradiction ouverte avec
l’Évangile :
L’égale dignité des personnes exige que l’on parvienne à des conditions de
vie plus justes et plus humaines. Les inégalités économiques et sociales
excessives entre les membres ou entre les peuples d’une seule famille humaine
font scandale. Elles font obstacle à la justice sociale, à l’équité, à la
dignité de la personne humaine, ainsi qu’à la paix sociale et internationale(1).
--------------------------------------
(1) Gaudium et spes
29, § 3.
Haut de page
III. La Solidarité humaine.
1939
Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom "d’amitié" ou
de "charité sociale", est une exigence directe de la fraternité
humaine et chrétienne(1) :
Une erreur, "aujourd’hui largement répandue, est l’oubli de cette loi de
solidarité humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la
communauté d’origine et par l’égalité de la nature raisonnable chez tous les
hommes, à quelque peuple qu’ils appartiennent, que par le sacrifice de
rédemption offert par Jésus-Christ sur l’autel de la Croix à son Père
céleste, en faveur de l’humanité pécheresse"(2).
--------------------------------------
(1) cf. Sollicitudo
rei socialis
38-40 ; Centesimus annus
10 – (2) Summi pontificatus.
1940
La solidarité se manifeste en premier lieu dans la répartition des
biens et la rémunération du travail. Elle suppose aussi l’effort en faveur
d’un ordre social plus juste dans lequel les tensions pourront être mieux
résorbées, et où les conflits trouveront plus facilement leur issue négociée.
1941
Les problèmes socio-économiques ne peuvent être résolus qu’avec
l’aide de toutes les formes de solidarité : solidarité des pauvres entre
eux, des riches et des pauvres, des travailleurs entre eux, des employeurs et
des employés dans l’entreprise, solidarité entre les nations et entre les
peuples. La solidarité internationale est une exigence d’ordre moral. La paix
du monde en dépend pour une part.
1942
La vertu de solidarité va au-delà des biens matériels. En répandant les
biens spirituels de la foi, l’Église a, de surcroît, favorisé le
développement des biens temporels auquel elle a souvent ouvert des voies
nouvelles. Ainsi s’est vérifiée, tout au long des siècles, la parole du
Seigneur : "Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît" (1) :
Depuis deux mille ans, vit et persévère dans l’âme de l’Église ce sentiment
qui a poussé et pousse encore les âmes jusqu’à l’héroïsme charitable des
moines agriculteurs, des libérateurs d’esclaves, des guérisseurs de malades,
des messagers de foi, de civilisation, de science à toutes les générations et
à tous les peuples en vue de créer des conditions sociales capables de rendre
à tous possible une vie digne de l’homme et du chrétien (2).
--------------------------------------
(1) Matthieu 6, 33 – (2) Pie XII, discours
1er juin 1941.
En bref.
Haut de page
1943
La société assure la justice sociale en réalisant les conditions permettant
aux associations et à chacun d’obtenir ce qui leur est dû.
1944
Le respect de la personne humaine considère autrui comme un " autre
soi-même ". Il suppose le respect des droits fondamentaux qui
découlent de la dignité intrinsèque de la personne.
1945
L’égalité entre les hommes porte sur leur dignité personnelle et sur les
droits qui en découlent.
1946
Les différences entre les personnes appartiennent au dessein de Dieu qui veut
que nous ayons besoin les uns des autres. Elles doivent encourager la
charité.
1947
L’égale dignité des personnes humaines demande l’effort pour réduire les
inégalités sociales et économiques excessives. Elle pousse à la disparition
des inégalités iniques.
|

